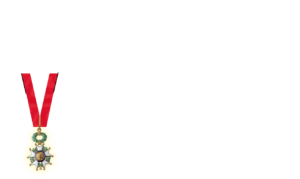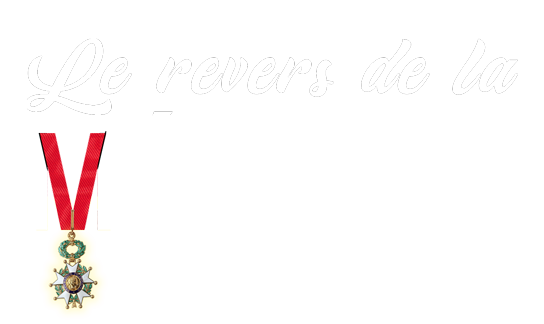En ce 10 octobre, nous commémorons les 123 ans de la naissance de Pierre Kœnig, le héros de Bir Hakeim. Fantassin, chasseur alpin et légionnaire, il résista sur tous les fronts où il lui fut donné de se battre : Norvège, Afrique subsaharienne, Syrie, Libye, Égypte et Tunisie.
Retour sur une carrière exceptionnelle ponctuée d’un riche parcours phaléristique, qui nous permettra de comprendre comment cet engagé volontaire de 1917 est devenu le dernier maréchal de France de l’Histoire…
Une vocation militaire précoce

Issu d’une famille d’origine alsacienne, Pierre Kœnig est né le 10 octobre 1898 à Caen. Fils d’un facteur d’orgues mutilé de la guerre franco-allemande de 1870, il manifeste son envie de « devenir général » dès l’âge de huit ans !
Tandis que la Grande Guerre éclate, le lycéen veut rejoindre l’Armée, mais son père l’incite à d’abord obtenir son baccalauréat. C’est chose faite en 1917, il peut donc s’engager au 36e régiment d’infanterie…
Premiers faits d’armes
Promu aspirant en février 1918 après avoir suivi la scolarité de l’école d’aspirants d’Issoudun, il rejoint son unité sur le front des Flandres dès le mois d’avril et prend notamment part aux batailles du Matz et de l’Ailette.


Cité et décoré de la médaille militaire le 8 septembre 1918 pour s’être « particulièrement distingué en entraînant sa section à l’attaque d’un bois solidement tenu et fortifié par l’ennemi », il est promu sous-lieutenant et décide de rester dans l’Armée à l’issue du conflit.
Suite à l’Armistice, Kœnig va servir successivement en Silésie, en Allemagne et au Maroc, où il obtient ses galons de capitaine en prenant part à la pacification du pays avec le 4e régiment étranger.
Participant aux diverses opérations de nettoyage dans l’Atlas, il sera nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1934 et restera déployé en Afrique du Nord jusqu’à ce que la France déclare la guerre à l’Allemagne nazie, le 3 septembre 1939.
La Seconde Guerre mondiale

Après des mois de « drôle de guerre », Kœnig quitte le Maroc en février 1940 et prend part à la campagne de Norvège, où pour la première fois les forces alliées se confrontent à la Wehrmacht.
Son débarquement à Namsos sous le feu des Stukas allemands lui vaut d’être nommé officier de la Légion d’honneur et contribue à freiner l’avancée des Allemands en Norvège. Cependant, quelques jours plus tard, le Reich allemand passe à l’offensive en France.
La défaite britannique à Dunkerque qui s’ensuit provoque l’évacuation des troupes déployées en Norvège. Rapatrié en juin, Kœnig se heurte à l’impossibilité de reprendre le combat sur le territoire national. Il décide alors d’embarquer pour l’Angleterre, afin de rejoindre le général de Gaulle.
Arrivé à Londres le 21 juin, il se met aux ordres du chef de la France libre et lui obtient le ralliement du 2e bataillon de Légion. Parmi les missions qui lui sont confiées, il joue un rôle prépondérant dans la campagne du Gabon en novembre, ce qui permit aux Forces françaises libres (FFL) de disposer d’une base arrière en Afrique équatoriale.
L’homme de Bir Hakeim
Kœnig devient général de brigade en juillet 1941. Il combat alors en tant que commandant de la 1ère brigade française libre en Lybie, notamment lors de la fameuse bataille de Bir Hakeim (du 27 mai au 11 juin 1942).
Durant seize jours, Kœnig et ses 3 722 hommes résistèrent aux attaques de l’Afrikakorps commandée par le général Rommel et constituée de 37 000 soldats !

Tenant sans relâche la position de Bir Hakeim, les Français finissent par percer les lignes italo-allemandes et rejoindre les forces britanniques dans la nuit du 10 au 11 juin. Cette victoire stratégique permit à la VIIIe armée britannique de se réorganiser à El Alamein.
Il s’agira de la première grande victoire de la France libre qui consacrera le renouveau de l’Armée française, confirmé plus tard par les victoires de Juin en Tunisie et en Italie, la prise par de Lattre de Tassigny de Toulon et Marseille et la libération de Paris et Strasbourg par Leclerc.
L’exploit de Kœnig lui vaudra notamment d’être nommé compagnon de la Libération en juin 1942 et décoré du Distinguished Service Order (ordre du Service distingué) par les Britanniques le mois suivant.

Général Kœnig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil !
Général de Gaulle
D’El Alamein à Paris
Le général Kœnig prend ensuite part à la seconde bataille d’El Alamein en octobre 1942 et à la campagne de Tunisie en avril 1943, marquant la fin de la présence des forces de l’Axe en Afrique du Nord.
Par la suite, le 1er août 1943, il prend les fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée à Alger, ce qui lui permettra d’unifier les troupes d’Afrique du Nord et celles de la France libre, causant la dissolution des FFL et la création de l’Armée française de la Libération.

Tandis que le Commandement en chef français d’Alger, dirigé par le général Giraud, et le Comité national français de Londres fusionnent pour former le Comité français de la Libération nationale, Kœnig est nommé délégué en mars 1944 et prend en parallèle les fonctions de commandant des Forces françaises de l’intérieur.
Promu général de corps d’armée, il devient gouverneur militaire de Paris le 21 août, quatre jours avant la libération de la capitale, et marchera aux côtés du général de Gaulle lors de la descente des Champs-Élysées.

L’après-guerre
Suite à la victoire sur l’Allemagne nazie, le général Kœnig est chargé de l’arrestation et de l’escorte du maréchal Pétain jusqu’au fort de Montrouge, son lieu de détention temporaire. Quelques semaines plus tard, il devient commandant des Forces françaises en Allemagne avec pour objectif d’aider le pays à retrouver une organisation démocratique.

Il quitte ensuite son poste en août 1949, estimant que l’administration militaire indispensable au début de l’occupation pour remettre de l’ordre devait désormais céder la place à un régime plus souple confié à des autorités civiles. Il est alors élevé à la dignité de grand’croix de la Légion d’honneur.


Du glaive à la toge

Après une riche carrière militaire, Kœnig est élu à la députation du Bas-Rhin en 1951, un territoire encore meurtri par le récent conflit mondial.
Nommé ministre de la Défense et des Forces armées dans le gouvernement Mendès-France (de juin à août 1954), il le redevient au sein du cabinet d’Edgar Faure (de février à octobre 1955) avant d’être réélu député en 1956.
Président du comité de l’association « France-Israël » dans les années 1960, il décédera le 2 septembre 1970 à l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine.
Le dernier maréchal de France
Tandis que les derniers maréchaux étaient Jean de Lattre de Tassigny, Philippe Leclerc de Hauteclocque et Alphonse Juin en 1952, Pierre Kœnig a été élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume par décret du 6 juin 1984.

« Le Gouvernement de la République a estimé qu’il méritait de la nation un témoignage de reconnaissance et de gratitude à la mesure de ses services » avait alors déclaré le président de la République, François Mitterrand.
Cette distinction, la plus haute de l’armée, constitue une dignité dans l’État et récompense uniquement les généraux ayant commandé une armée victorieuse.

Outre les sept étoiles, cette dignité est symbolisée par un bâton de velours bleu parsemé d’étoiles sur lequel est écrit « Terror belli, decus pacis » (terreur durant la guerre, ornement en temps de paix).
L’Histoire de France compte 342 maréchaux de France. Si Kœnig est le dernier maréchal de France à ce jour, le premier fut Albéric Clément, seigneur de Mez, nommé par le roi de France Philippe Auguste en 1185.